XVIIe siècle
-
-

Rédigées vers 1734, les Réflexions sur la Monarchie universelle en Europe actualisent alors l’anti-absolutisme des Considérations sur les causes de la grandeur des Romains (1734) et s’inscrivent dans la genèse de l’Esprit des Lois (Genève, 1748). Expression de la philosophie des Lumières qui prend forme avec la publication des Lettres persanes (1721), ce texte incisif, oublié puisque Montesquieu en détruisit toute l’édition, montre que l’instabilité de l’État naît avec l’esprit de conquête: la “monarchie universelle” représente le stade suprême de l’absolutisme avant son déclin. En synthétisant l’histoire européenne entre la chute de Rome, ruinée par son hégémonie, et le déclin de la France belliqueuse de Louis XIV, Montesquieu plaide pour une Europe pacifiée, débarrassée de ses “mercenaires”, ordonnée par des lois adaptées aux mœurs et unie dans le commerce réciproque, matrice de la paix entre les nations. Avec cette histoire philosophique du droit des gens qui récuse tout providentialisme, Montesquieu adhère à la modernité politique à laquelle aspirent les Lumières en condamnant la guerre offensive et l’hégémonie d’un État sur un autre. Donnant tout son sens au thème montesquien de la modération, la Monarchie universelle en Europe constitue une source importante pour l’histoire critique de l’hégémonie militaire et politique.
-

Il est maintenant établi que les différents ouvrages de Robert Challe ont amené à redéfinir les limites des genres littéraires français au XVIIIe siècle. Ainsi, le genre romanesque s’ouvre désormais avec les Illustres Françaises, et celui des journaux intimes ou des confessions avec le Journal de voyage aux Indes, de Robert Challe. Enfin, le siècle de la “philosophie” a trouvé une expression aussi précoce que frappante avec les Difficultés sur la religion proposées au père Malebranche. Mais s’il n’est pas une thèse de cet ouvrage qui ne se retrouve plus tard chez Voltaire, il est aussi le seul, dans la littérature “clandestine”, à retracer l’itinéraire biographique et spirituel qui a conduit son auteur d’un catholicisme dévot à un rationalisme encore marqué par ses origines religieuses. C’est une des nouveautés de la présente édition que de dégager ce déisme quasi-évangélique des falsifications qui en avaient fait, sous le titre menteur du “Militaire philosophe”, un bréviaire du matérialisme de Naigeon. La présente édition des Difficultés sur la religion d’après un manuscrit enfin fidèle et complet couronne la publication dans les Textes Littéraires Français (voir les n° 400, 438, 466 et 494) des œuvres du digne interlocuteur de Nicolas Malebranche.
-
-
-
-

Cette édition reproduit pour la première fois depuis le XVIIe siècle, le texte de Dom Juan édité à Amsterdam en 1683. C’est la seule version de la pièce de Molière produite en «collaboration» avec la censure française permettant de préciser tous les passages qui ont été jugés scandaleux et de reconstituer ainsi la version «originale». Jusqu’ici, les éditeurs de Molière choisissaient, chaque fois de manière différente, les variantes du texte d’Amsterdam qu’ils reproduisaient. Fidèles aux principes qui gouvernent actuellement l’édition de Shakespeare, nous donnons dans son intégralité ce texte, publié presque certainement d’après une transcription de la pièce telle qu’elle avait été jouée par la troupe de Molière en 1665. Nous revenons ainsi à un premier Dom Juan, aussi proche que possible du texte créé par Molière.
Extraits d'un article paru dans "Le monde" du vendredi 16 juillet 1999: UN "FESTIN" ÉDITORIAL, " Le "Dom Juan" de Molière connut au moins trois versions. A un texte "composite", Joan Dejean a préféré l'édition de 1683, qui échappa à la censure du roi et des comédiens de Molière. Un parti pertinent. (...) De là, le choix différent de Joan Dejean pour la très belle édition qu'elle publie chez Droz et qui constitue le 500ème titre de la vénérable collection "Textes littéraires français". Inspirée par les pratiques éditoriales de la critique shakespearienne, elle publie l'un des Dom Juan, à savoir, le Festin de pierre tel qu'il est paru à Amsterdam en 1683, dont elle se limite à corriger les coquilles. Un tel parti lui permet, à la fois, de respecter l'intégrité du texte tel qu'il a été imprimé dans l'un de ses états et de s'interroger sur les raisons qui ont fait que, durablement, la pièce de Molière n'a été connue en France que défigurée et aseptisée." Roger Chartier
-
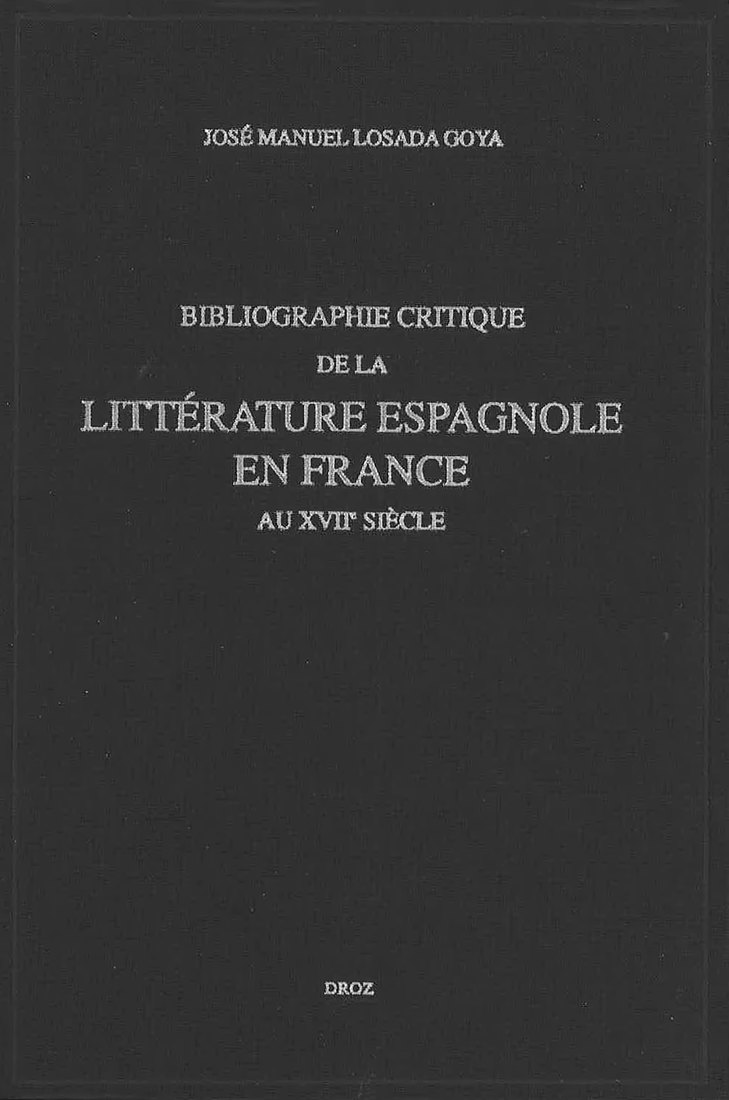
La dette de la littérature française contractée envers la production espagnole du Siècle d’Or est reconnue. Un exemple : entre 1614 et 1618 parurent les deux parties du Don Quichotte. Deux notices de cette Bibliographie critique décrivent la fidélité, les habiletés, les déboires et le succès de la tradition d’Oudin et de Rosset jusqu’à la nouvelle refonte de Filleau de St-Martin (1677-78). Une soixantaine de notices étudient les nouvelles, les pièces de théâtre et les poésies centrées sur l’illustre hidalgo. La description des premières éditions et des réimpressions de tous les ouvrages, les index et les renvois font des 517 entrées de cette bibliographie un outil indispensable pour l’étude des rapports franco-espagnols au XVIIe siècle.
Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle. Un article paru dans ABC, grand journal national espagnol, fait l'éloge du dernier livre de José Manuel Losada Goya intitulé "Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle". Ce chef d'oeuvre ouvre de nouvelles voies dans l'histoire des littératures comparées. L'influence des grands auteurs espagnols dans la littérature française du XVIIe siècle, les traductions et imitations d'un Cervantes.... sont autant des thèmes abordés dans cet ouvrage. Voici quelques extraits de l'article : "La "Bibliographie critique de la littérature espagnole en France au XVIIe siècle" de José Manuel Losada Goya es una obra monumental que está llamada a abrir innumerables caminos para la historia de las literaturas comparadas. (...) Con intachable pulcritud, Losada Goya ha circunscrito su espléndida investigación al siglo XVII. Bastaría con alargar esa frontera temporal para descubrir que, en verdad, la influencia española fue mucho más honda."
Juan Pedro Quiñonero
ABC, el 3 de agosto de 1999
-
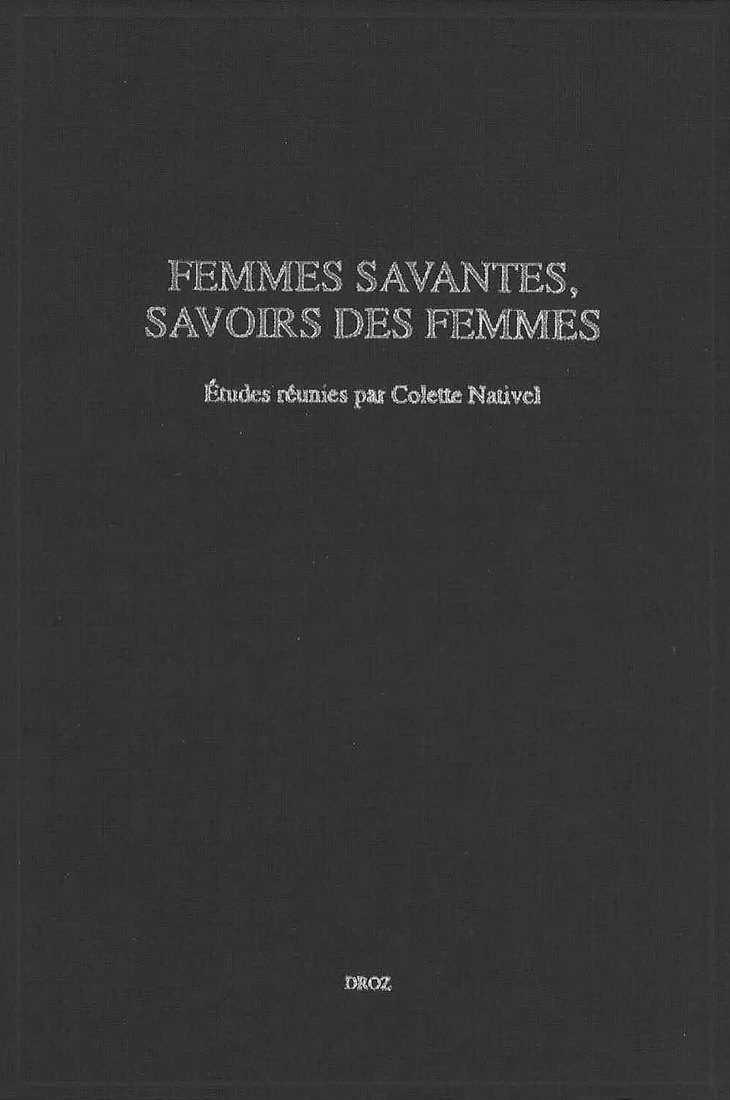
Ce colloque, qui s’est tenu au Centre Culturel des Fontaines en septembre 1995, envisage différents aspects de l’évolution du savoir féminin à l’époque moderne, sa nature, ses contestations éventuelles. La première partie vise à ancrer la réflexion dans la réalité, souvent complexe de la période. Elle étudie les cadres institutionnels qui définissent l’activité féminine et la diversité des savoirs féminins. La seconde partie aborde l’éloge ou la contestation de ce savoir, sa place dans l’histoire des moeurs, des institutions et des idées. Enfin, sept portraits exemplaires de femmes savantes viennent compléter ce panorama.
REALITES/SAVOIRS: - Christian Biet. Quand la veuve contre -attaque : droit et fiction littéraire sous l'ancien régime. - Bruno Neveu. Doctrix et Magistra. - Colette Winn. Les femmes et la rhétorique de combat : argumentation et (auto) référentialité. - Nathalie Grande. L'instruction primaire des romancières. - Sabine Juratic. Marchandes ou savantes? Les veuves des libraires parisiens sous le règne de louis XIV. - Pierre Maréchaux. Savoir des doigts, savoir des voix. REGARDS D'HOMMES: - Jean Céard. Listes de femmes savantes au XVIe siècle. - Brenda Hosington. Learned ladies : éloges de l'anglaise savante (1550-1558). - Nicole Jacques-Chaquin. La curiosité sorcière : représentations du désir féminin du savoir chez les démonologues (XVIe-XVIIe siècles). - Sophie Houdard. Possession et spiritualité : deux modèles de savoir féminin. - Philippe Salazar. Elizabeth à Descartes : "Etre mieux instruite de votre bouche". - Jean-Charles Darmon. La fontaine et le savoir des muses. DISCOURS DE FEMMES/PORTRAITS: - Eliane Viennot. Ecriture et culture chez Marguerite de Valois. - Chantal Morlet Chantalat. Parler du savoir, savoir pour parler : Madeleine de Scudéry et la vulgarisation galante. - René Démoris. Ecriture féminine en Je et subversion des savoirs chez Mme de Villedieu (les mémoires d'Henriette-Sylvie de Molière). - Emmanuel Bury. Madame Dacier. - Ralph Heyndels. Le cogito du néant : Jeanne Guyon dans l'épistémologie cartésienne. - Elisabeth Lavezzi. Catherine Perrot, peintre savant en miniature : Les leçons royales de 1686 et de 1693. - Henriette Goldwyn. Journalisme polémique à la fin du XVIIe siècle : le cas de Mme du Noyer.
-